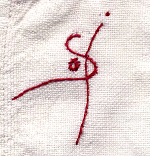(Le 20 juin 2006, ce jour précédant l’été, nous marchions Sofie Vinet et moi à Notre-Dame des Landes, sur un chemin entre les champs, dans la campagne du nord de Nantes. Elle y avait reconnu et inscrit son univers.)
A quelques mètres de l’invitation, une porte rouge est ouverte.
Rouge, le fil qui va nous conduire.
Rouge, la sève humaine invitée à circuler dans les artères de verdure.
Il faut partir.
Plantés, surgissant, s’imposant, les carrés brodés. La parole accrochée au bout de l’aiguille de Sofie Vinet se déploie.
Rouges, les mots.
Le fil passe dessus, dessous, se contorsionne, se noue, se dénoue. Il inscrit sur le tissu blanc.
Il n’y a plus de blanc.
Elle a recueilli les mots à peine nés, les a disposés dans son grand panier avec ses bobines et ses écheveaux, ses aiguilles, ses ciseaux, son lin et son coton, ses étoffes, ses vieilles fripes, ses chemises et ses draps et ses torchons et ses mouchoirs.
Sofie Vinet la chiffonnière, la brodeuse-raconteuse-relieuse qui se souvient du temps des femmes dans l’ouvroir ou l’atelier ou la cuisine, près du poêle ou de la cheminée à la mauvaise saison, sur le banc de pierre ou sous le tilleul de la cour de ferme durant l’été, les femmes qui, en faisant courir l’aiguillée, tiraient sur les mots et avec eux venaient la délivrance et les rubans pour lier les histoires et les parer.
Elle fait courir le fil de l’ailleurs enfoui en soi à l’ici ragaillardi. Elle nous dit, oui on est toujours celle, celui que l’on a été, ce n’est pas l’oubli que fera place à demain, c’est la visite aux racines nourricières. Ainsi se déplient des espaces sur ses carrés brodés :
de vous à moi
je cueille des paroles supposées senties parfois entendues
de moi à vous
broder pour le plaisir OUI pas seulement
capter une émotion entendre une pensée
la sensation que l’enveloppe peau est trop tendue
Déjà une malle antique de notre mémoire est descellée. La serrure a sauté, on ne saura la refermer. Elle offre des révélations : vois ce que tu n’avais pas vu et ce que la vie a fait de toi, vois les vides à combler, les effilochures, les démaillages et les accrocs.
Le fil rouge.
Le premier filet de sang des premières menstrues mais il serait trop évident de s’en tenir là. Avec Sofie Vinet, pas de pause. Il faut entrer dans l’écoulement. Devenir cet écoulement pour la suivre. Un arrêt et ce serait la menace de sédiments, comme ces robes qu’elle dépose dans le lit des dégorgements des argiles minières.
Pétrifiés, on le serait comme le sont désormais les fibres minérales.
Interrogée par les filiations, Sofie Vinet nous propose des passages, des mutations, des transmutations.
Pour l’heure, sous le couvert végétal, sous la protection complice des arbres, on navigue de l’enveloppe à la
chair. Le fil rouge conduit de l’un à l’autre, dessus, dessous. Dessus, on veut bien donner à voir, dessous, on lie et attache avec nœuds et accroches, les retenues et les silences. Les mots qui s’inscrivent sur le blanc des carrés, retrouvent, soulèvent d’autres mots inscrits. Un état dont l’origine mystérieuse s’empare de vous.
Ces mots-là, oui, je les ai pensés. Comment en a-t-elle recueilli la mousse ?
On suit l’aiguille qui a serpenté et on entend :
je ne sais pas de quoi j’ai envie moi
repartir ou revenir est-ce donc si difficile ?
résistances
sous la cicatrice une résistance qui étouffe
se raconter tard dans la nuit laisser venir les mots aller la souffrance
Et s’estompent les chagrins. Les mots ici en courant les effacent. Avec soin et tendresse.
De l’autre, Sofie Vinet ignore ce qu’elle sait. Elle se porte vers lui d’un ample et généreux mouvement, pleine de confiance sereine. Derrière, mais avec elle qui ouvre la voie, entraîné par elle, on pénètre un peu plus loin.
A l’instant où une tension se relâche, avant de continuer, on s’arrête. Il y a ici comme un coude, une articulation. Une table rouge, une chaise rouge, derrière eux un écritoire transparent monte, se déploie entre les 2 branches. Un souffle balance les mots ainsi suspendus. Seraient-ce ceux des silences ? Ceux que seul le vent sait porter ?
écouter le murmure des mots
se poser
laisser aller
venir les images
recueillir une pensée
surprendre l’émotion
déposer
le souvenir
entonner la ritournelle
toujours la même celle à trois temps
Rouge, la chaise. Tellement pleine de vies un moment arrêtées, quand le corps n’en peut plus de fatigues ou de joies trop fortes. A côté de la table qui n’est pas celle du repas.
Rouge, la table. Rouge de blessures et d’émotions coagulées. Le regard se détourne, on ressent un appel.
Car il y a dans l’air, en cet endroit, un appel à progresser sous la voûte berçante. Une énergie vous propulse. Une trouée d’où fuse la lumière. Les arbres s’écartent. Le regard tant contenu se déverse dans un champ de blé après avoir frôlé et caressé les avoines folles qui en dansant tracent ses contours.
Devant la fenêtre lumineuse, à ses pieds, pourrait-on dire, trois sacs de vieille toile. Trois sacs serrés l’un contre l’autre. Pleins du labeur de l’homme. Serait-ce façon de dire à ses pères, à ses hommes, merci, sachez que je vous porte et vous me portez, nous échangeons nos fardeaux, sans vous rien de ce que nous sommes ne serait, merci à vous pour ce sang que vous activez en nous, pour le plaisir qui nous rend plus grandes, pour nos maternités, nos lumineuses attentes et merci aussi (peut-être le dit-elle) pour les abandons et les pertes qui nous rendent plus légères.
Blancs, les trois sacs.
Il n’y a pas d’inscriptions. Pas de broderies. Le fil rouge a été coupé. Les mots ici sont inutiles.
Impossibles pour eux de prendre forme dans l’ardeur des heures tendues de chaleur intense, de sueur inondant les corps, dans le froid mordant, les doigts gourds qu’une haleine à peine tiède ne parvient pas à réchauffer, dans la boue, les ornières gluantes, les coups de reins à donner et les mains dont on regrette les cals quand il s’agit de caresser au soir d’une fatigue qui voudrait encore aimer.
Dans le premier sac, des pierres.
Dures d’une roche qui heurte les socs et les brise avant d’être entamée. Des pierres que les paysans amassent après l’hiver. Le champ s’offre alors tendre et disposé à l’ensemencement. Emportant tracas, calamités et chagrins, elles iront recouvrir un chemin. Et la peine pour avancer sera plus légère.
Dans le deuxième, le blé a poussé. Les tiges vertes débordent. Bientôt, la gueule béante disparaîtra quand la force contenue sera tout entière libérée. Chaque tige porte une voix. C’est la voix des victoires sur les pièges de la terre, sur les aléas des saisons et les caprices des germinations, c’est la voix qui fait entendre la fierté et le cœur satisfait des promesses tenues.
Dans le troisième, la terre. Comme il est bouleversant, ce sac-là ! La terre est grise, poussiéreuse et grossière. Elle est celle que nous deviendrons et aussi celle d’où naît l’avenir. Elle le contient en silence, en secret. Le contient et contient les espoirs, les attentes, les questions. On ne sait jamais quand elle acceptera de se poudrer de vert. Après la première pluie, mais quand, et si les oiseaux, et si les erreurs rejoignaient les doutes. Et si nous nous étions égarés.
Au bord du chemin, trois sacs. En les dépassant, avec soi, on emporte un peu de chacun. L’air en
devient plus dense et la respiration plus ample.
Notre sang en avait besoin.
Plus tard, après être passé au-delà des robes, on le saura.
Les robes surgissent. On reçoit en plein cœur leur apparition. En cet endroit, le couvert des arbres plus épais et mieux défini, en s’abaissant, bâtit une demeure. Une armoire ouverte siège dans la pièce principale et ne laisse voir que le nécessaire à la parade des trois robes. Trois robes blanches que le plus ténu des souffles du vent suffit à faire tourner. Elles virent, elles vivent.
Blanches, les trois robes.
On découvre d’abord celle d’une fillette qui rêvait autrefois dans un habit de mousseline. Page vierge prête à recevoir les signes et à être marquée de sceaux. Les désirs, les espoirs insensés, les songes innombrables se peignent en blanc dans la tête des petites filles. Celle qui a habité la robe est encore là. Le corps frêle, les bras roses dans les manches ballon, les jambes grêles et, dans leurs socquettes blanches, les pieds chaussés de vernis 3 noirs, et aussi le visage rieur qui n’en revient pas du faste de ce jour de fête pour lequel la robe a été cousue. La petite fille a quitté la robe depuis longtemps, elle l’a pourtant revêtue quelques instants dans la grâce des bras attendris des arbres.
Avant de se glisser dedans, celle qui n’est plus une petite fille a d’abord caressé des yeux l’autre robe blanche. En quelques années le tissu s’est alourdi. Quels poids imprévus a-t-il absorbés et retenus ? Ce n’est pas la robe légère d’un jour d’épousailles. C’est la robe d’une femme jeune et déjà mère dont le corps a été empli, un être s’est créé au creux des chairs douces et tièdes. D’une rupture sanglante, rouge de vie, un enfant est né. La femme danse dans cette robe. Ses épaules rondes sont dénudées, elle rit du bonheur de l’instant dans des bras aimés, elle tourne comme tourne la robe aujourd’hui encore dans la protection vivante du sous-bois.
Y a-t-il eu assez de rires ? En aurais-je gâché un ? Ai-je assez bercé ? Assez dansé ? se demande celle qui plie son corps avec infinie lenteur pour entrer dans la troisième robe blanche. Suis-je vraiment si petite ?
Comment mes os, mes chairs ont-ils pu se resserrer ainsi ? Comment est-ce possible ? Il me faut si peu d’espace maintenant, si peu, et tellement de temps. J’ai besoin de temps, je ne suis pas prête.
La troisième robe blanche. Celle d’où ne sortira pas la femme de l’âge. Celle des effacements, des disparitions. Un à un s’en sont allés les souvenirs et avant eux un à un les êtres aimés. Les autres, enfants et petits-enfants disent être là, tout proches. Elle est seule à voir l’artifice et à savoir combien elle s’éloigne.
Quand on abandonne la maison sous les arbres, la vieille femme et sa dernière robe blanche, on sent la nécessité d’un don. Un léger frisson, un silence étranglé avant que les paupières ne se baissent sur des larmes retrouvées.
Voici que tout un peuple d’aïeules, de sœurs, de filles nous accompagne désormais. Dans leur matrice, elles cajolent l’avenir.
Avec elles, on poursuit notre chemin et on entend leurs voix :
résister et survivre
sans enfant parce que la vie a fait que
ne rien attendre laisser venir
tricoter les fils de nos amours
vas-y !
elle avait les yeux rouges nous ne nous sommes rien dit
être dans l’essentiel au-delà de toute vanité.
Des ondes courent sur la peau avec les derniers mots. On franchit à nouveau la porte rouge, elle restera ouverte.
marie-hélène bahain